HAPI / KORAK
Les Albanais de la Vallée de Presevo
et les discussions sur le statut du Kosovo
TRADUIT PAR MANDI GUEGUEN
Publié dans la presse : mars 2005
Mise en ligne : mercredi 6 avril 2005
Les Albanais de la Vallée de Presevo
veulent avoir leur mor à dire dans les discussions qui vont s’ouvrir
sur le statut final du Kosovo, mais cette hypothèse n’est pas retenue
par la communauté internationale, attachée au respect des frontières.
Les Albanais veulent cependant lier leur sort de minorité nationale en
Serbie à celui des Serbes du Kosovo...
Par Belgzim Kamberi
À la suite des efforts intenses de la
diplomatie internationale, le dialogue concernant la question des
personnes disparues a repris entre Pristina et Belgrade début mars, comme
l’annonçait récemment le chef de la Mission des Nations Unies au
Kosovo (MINUK), Soren Jessen-Petersen.
Même si le dialogue bilatéral se
focalisera en premier sur la question des disparus et d’autres problèmes
techniques, il est perçu comme le début de la solution du statut final
du Kosovo, administré par les Nations Unies depuis la fin des
bombardements de l’OTAN (juin 1999) contre l’ex-Yougoslavie, désormais
Serbie-Monténégro. Le président de la Serbie, Boris Tadic, a déclaré
lors d’une interview à l’agence Beta, qu’en juin ou juillet
prochain, il pourrait y avoir une accélération des pourparlers sur le
statut du Kosovo, dont l’indépendance reste pour lui inacceptable.
Le Président du Parlement du Kosovo,
Nexhat Daci, a rappelé l’importance de l’année 2005 pour la définition
de l’indépendance du Kosovo et la garantie de sa stabilité politique.
Jusqu’à ce que les deux parties aient exposé leurs avis antinomiques
sur l’aboutissement de ce dialogue, pour les représentants politiques
de la minorité albanaise de la Vallée du Presevo, au sud de la Serbie,
ce dialogue représente l’occasion de réaliser leurs revendications.
Orhan Rexhepi, un ex-commandant de la guérilla locale albanaise dissoute,
désormais dirigeant du Mouvement du progrès démocratique, explique
qu’ il n’est « guère nécessaire d’impliquer la Vallée
de Presevo dans le cadre des discussions sur les questions techniques,
mais une délégation des Albanais de Presevo doit participer au dialogue
sur le statut final du Kosovo ».
Les complications
Selon les hommes politiques locaux
albanais, la question de la Vallée de Presevo est fortement reliée à
celle du Kosovo, et cela justifie leur participation au débat Pristina -
Belgrade. « Beaucoup de problèmes seront discutés entre Pristina
et Belgrade, et ils concernent aussi la problématique des Albanais de la
Vallée de Presevo, comme la question des études universitaires, la libre
circulation des personnes et des marchandises, etc. Il serait, dès lors,
plus pratique et pragmatique que la solution des problèmes de la minorité
albanaise de la Vallée de Presevo soit résolue à ce moment-là pour ne
pas repousser les problèmes », affirme le maire de Presevo, qui
dirige aussi le Parti pour l’action démocratique, Riza Halimi.
Jusqu’à présent, personne ne juge nécessaire
d’inclure la question de la Vallée de Presevo dans le dialogue entre
Pristina et Belgrade. Belgrade craint que cette revendication ne renforce
l’idée d’une union éventuelle entre ces communes du sud de la Serbie
et le Kosovo.
Certains cercles albanais locaux désirent
cette union. Misa Markovic, vice-président du Corps de Coordination pour
le Sud de la Serbie, organe officiel du gouvernement de Belgrade chargé
de la région de Presevo, Bujanovac et Medvedja, soutient qu’elle fait
partie de la Serbie et que les Albanais peuvent réaliser leurs droits
dans le cadre de l’État. Le dialogue prévu étant un dialogue sur le
Kosovo, et non un dialogue albano-serbe, la question de la Vallée de
Presevo ne doit pas intervenir.
La Vallée de Presevo, habitée depuis des
siècles par une partie des nations albanaise et serbe, continue à être
une région problématique pour les deux communautés. Si les Serbes
considèrent cette province comme partie historiquement constituante de la
Serbie, les Albanais qui représentent la majorité soutiennent que cette
région a appartenu à l’espace territorial du Kosovo jusqu’en 1948,
au moment de son union à la Serbie pour des raisons géostratégiques, et
en échange de deux communes peuplées majoritairement de Serbes :
Leposavic et Zubin Potok, incorporées au Kosovo à cette date. Pendant
toute la durée du régime de Milosevic, les Albanais locaux ont subi des
discriminations aussi bien politiques que socio-culturelles. Le 1er et le
2 mars 1992, les acteurs politiques albanais locaux ont organisé un Référendum
illégal, où la majorité absolue des votants s’est déclaré pour une
« Autonomie territoriale et politique et le droit de s’unir au
Kosovo ».
Au début de l’année 2000, un conflit
armé a éclaté dans ces régions entre les membres de la guérilla
locale albanaise, l’Armée de Libération de Presevo, Medvedja et
Bujanovac (UCPMB), et les forces officielles de sécurité, provoquant une
centaine de morts. Il a pris fin après une série de pourparlers entre
les représentants albanais locaux et le gouvernement de Belgrade, avec la
médiation des représentants internationaux. Après les promesses de
Belgrade et les suggestions des internationaux, les Albanais ont accepté
le statut de minorité nationale et l’intégration dans le système de
la République de la Serbie, sous condition de jouir de leurs droits selon
les normes européennes.
« La revendication des acteurs
politiques albanais de cette région d’impliquer la Vallée de Presevo
dans le dialogue Pristina-Belgrade ne signifie pas que nous demandons
l’union de ces communes au Kosovo, ou la transformation des frontières
serbes ou kosovares », affirme Riza Halimi, qui n’est apparemment
pas rejoint dans cette idée par les autres leaders albanais.
Ragmi Mustafa, Président du Parlement
Communal du Presevo et du Parti démocratique albanais, favorise une
solution politique plus régionale : « depuis Rambouillet il a
fallu que les pourparlers prennent un caractère albano-serbe, puisque le
problème albanais concerne tout l’espace ex-yougoslave. Depuis 1999, il
a fallu traiter les problèmes des Albanais au Monténégro, dans la Vallée
du Presevo et en Macédoine ».
Les refus
L’analyste belgradois Dusan Janjic
explique que la capitale serbe n’acceptera pas la revendication
albanaise du Sud de la Serbie de participer au dialogue entre Pristina et
Belgrade, qui ne considère pas le problème des Albanais du Sud de la
Serbie comme une question de minorité interne.
De même, les structures internationales
ne semblent pas prêtes à examiner la revendication de la Vallée de
Presevo, sous prétexte qu’elle ne fait pas partie du Kosovo. Rémi
Dourlot, porte-parole de la MINUK affirme que la cadre défini pour le
dialogue Pristina-Belgrade est constitué de représentants des
institutions temporaires de l’auto-administration au Kosovo et de représentants
officiels de Belgrade. « La Résolution des Nations Unies couvre le
territoire du Kosovo tel que défini en 1974, soit l’espace
aujourd’hui administré par la KFOR et la MINUK. De ce fait, le mandat
de la MINUK ne concerne que ce territoire », soulignent également
les analystes de l’International Crisis Group (ICG), pour expliquer
l’attitude de la MINUK.
Dusan Janjic affirme que le refus de la
MINUK et de la communauté internationale en général tient à la crainte
de voir s’ouvrir une « question albanaise » dans le cadre
des discussions Pristina-Belgrade. « Dans ce cas, ils seraient
contraints de traiter la question de la Bosnie et d’autres problèmes régionaux,
et cela ne les intéresse pas d’ouvrir cette question dangereuse »,
relève-t-il.
Les leaders politiques albanais analysent
ce refus des internationaux comme une stratégie visant un début efficace
du dialogue, pour traiter les problèmes en temps et heure et ne pas
compromettre les effets positifs.
Le gouvernement du Kosovo ne s’empresse
pas de se prononcer sur la question d’une implication possible de la
Vallée du Presevo dans le processus de négociations entre Pristina et
Belgrade. Une source anonyme du gouvernement, qualifie ces revendications
de « nuisibles pour le processus d’indépendance du Kosovo ».
Le leader du plus grand parti d’opposition, le Parti démocratique du
Kosovo (PDK), et ancien commandant politique de l’Armée de Libération
du Kosovo (UCK), Hashim Thaçi, a déclaré récemment, lors d’une
visite en Macédoine, que la solution du statut final du Kosovo sera un
Kosovo libre et indépendant, et non une Grande Albanie ou un Grand
Kosovo.
« Il existe la crainte qu’à jouer
la carte de la Vallée du Presevo, le Kosovo ne perde des points dès le début
du processus, et ne puisse être accusé par la communauté internationale
d’idée mégalomanes sur une « union des terres ethniques »
ou de vouloir la « Grande Albanie », et ne soit soupçonné de
vouloir changer les frontières, », explique l’analyste kosovar,
Halil Matoshi, pour éclaircir l’attitude du gouvernement kosovar. Il
souligne toutefois que si les Serbes calculent la possibilité de
partition du Kosovo, il se peut fort bien que Pristina mette sur la table
des négociations la question du statut des Albanais de la Vallée du
Presevo.
Parallélisme entre les Albanais de Presevo et les Serbes
du Kosovo
On sait qu’une partie des hommes
politiques de Belgrade favorisent publiquement la partition du Kosovo
selon des bases ethniques. Les divers sondages récents confirment la
position des Serbes en faveur de la partition ethnique du Kosovo : le
Nord pour les Serbes et le Sud pour les Albanais. « Si, pendant le
dialogue Belgrade-Pristina, on revient sur le principe de la préservation
des frontières actuelles, les choses prendront une tournure différente »,
dit Riza Halimi en faisant allusion au principe des frontières ethniques.
L’International Crisis Group souligne que ces plans peuvent avoir des échos
en Serbie. « Un bon conseil pour Belgrade serait de ne pas se
diriger vers une solution « à l’intérieur » du Kosovo, qui
provoquerait des tensions à Belgrade même pour des solutions semblables
« à l’intérieur » de la Serbie », affirment les représentants
de cette organisation à Pristina.
Dans quelques cercles politiques locaux et
internationaux, il y a la tentation constante de mettre en parallèle les
Albanais de la Vallée de Presevo et les Serbes du Kosovo. « Tout ce
qu’elle va gagner au Nord du Kosovo, la Serbie sera contrainte à le
rendre aux communes dans la Vallée de Presevo, et peut-être aussi aux
six communes hongroises de la Voïvodine. « Les grands facteurs
internationaux tendent vers la symétrie. Cela ne peut échapper qu’à
celui qui regarde la scène politique et la société d’un œil distrait »,
affirmait déjà l’ancien ministre des Affaires Etrangères de la Serbie
et du Monténégro, actuellement Coordinateur du Pacte de stabilité pour
l’Europe du Sud-Est, Goran Svilanovic, dans une interview à
l’hebdomadaire Monitor de Podgorica.
Les leaders politiques albanais de la Vallée
de Presevo affirment aussi que pendant les pourparlers Pristina-Belgrade,
la minorité albanaise de la Serbie devra bénéficier au moins du même
traitement et du même statut que la minorité serbe du Kosovo. Riza
Halimi soutient que « la sphère des droits collectifs est étroitement
reliée au statut des Albanais de la Vallée de Presevo et pèse du même
poids que le statut et la solution de la question des Serbes du Kosovo. La
revendication des Albanais de la Vallée de Presevo de réaliser leurs
droits dans le cadre du processus des négociations entre Pristina et
Belgrade, au même degré que les Serbes du Kosovo, est réelle et vitale ».
Or, les Albanais de la Vallée de Presevo ne sont pas dans la même
position politique et juridique que les Serbes du Kosovo. Le fait que la Résolution
1244 considère toujours le Kosovo sous la juridiction de la Serbie et du
Monténégro confère une position active aux structures de Belgrade pour
s’intéresser et influencer la vie du Kosovo, ce que ne peut faire
Pristina pour les Albanais de Presevo, Bujanovac et Medvedja.
Selon Ragmi Mustafa, cet argument ne tient
pas, car les Serbes du Kosovo constituent une minorité au même titre que
les Albanais en Serbie, et les deux minorités doivent jouir des mêmes
droits. Les représentants politiques albanais espèrent que les
pourparlers Pristina-Belgrade harmoniseront au moins les standards et le
statut des minorités.
« Bien qu’on ne puisse pas mettre
sur le même pied d’égalité la position des Albanais de la Vallée du
Presevo et celle des Serbes du Kosovo, nous avons à faire à des
processus identiques, même si le Kosovo est sous protectorat
international et que nous sommes dans le cadre d’un État reconnu
internationalement. Il est absurde de ne pas exiger des standards de
Belgrade pour les minorités, de la même manière qu’on l’exige de
Pristina », insiste Riza Halimi.
Selon Dusan Janjic, l’harmonisation des
standards pour les minorités serait un élément positif et productif
pour le renforcement de la stabilité régionale. Le standard pour la
protection des minorités doit être absolument le même aussi bien en
Serbie qu’en Macédoine et au Monténégro, pour éviter de nouveaux
conflits éventuels. Selon Dusan Janjic, les négociations
Pristina-Belgrade doivent examiner ces questions. Un dialogue productif
harmoniserait les standards de protection des minorités et des droits de
l’homme à Belgrade, Pristina, Presevo, Tetovo, Skopje, Podgorica. Le
Conseil de l’Europe pourrait organiser une table ronde pour un dialogue
multilatéral par exemple, affirme Dusan Janic. Pour les représentants de
la MINUK comme Rémi Dourlot, un résultat positif des pourparlers serait
une source d’inspiration et contribuerait à la définition d’un
statut assuré des minorités au Kosovo et celui des autres minorités.
La (non) intégration au débat
L’issue du dialogue délicat entre
Pristina et Belgrade est difficile à prévoir pour le moment. La Vallée
de Presevo restera sûrement à l’extérieur des priorités des facteurs
décisifs internationaux. Or, les responsabilités politiques des Albanais
de la Vallée de Presevo n’ont pas encore perdu l’espoir de leur éventuelle
participation dans les négociations. « Si les discussions se
concluent par l’indépendance du Kosovo, elles se dirigeront sans doute
vers une redéfinition de la frontière entre le Kosovo et la Serbie et,
dans ce cas, nous espérons que la question de la Vallée de Presevo
viendra sur le devant de la scène. Nous n’insistons pas pour faire
partie des négociations à tout prix, mais il faudra absolument trouver
un moyen pour faire parler de la Vallée de Presevo, en autorisant
Pristina à négocier la question par exemple », conclut Orhan
Rexhepi.
Les leaders albanais se disent prêts à
renoncer à leurs revendications en échange de l’indépendance du
Kosovo. « Si Pristina nous demande de rester en Serbie, pour
favoriser l’indépendance, nous sommes prêts à l’accepter pour ne
pas nuire au Kosovo. Si les Serbes du Kosovo acceptent de se soumettre à
la juridiction du Kosovo indépendant, nous sommes prêts à nous
sacrifier pour cette politique », relève Ragmi Mustafa.
Cependant, l’impression prévaut que la
revendication des Albanais de la Vallée de Presevo de participer aux négociations
sur le statut du Kosovo, rappelle l’expérience des Musulmans du Sandjak
il y a quelques années. Lalgré leur demande de participer aux négociations
de Dayton sur la solution de la crise bosniaque, ils furent laissés de côté
sous prétexte que seules les frontières administratives devaient être
prises en compte. Riza Halimi craint qu’un tel scénario ne se répète
pour les Albanais de la Vallée de Presevo lors de la résolution du
statut final du Kosovo.
|


 Serbie
: mort d’un témoin compromettant
Serbie
: mort d’un témoin compromettant
 Vu
de Croatie : la mort de Milosevic et le suicide de Babic sont-ils des
coïncidences ?
Vu
de Croatie : la mort de Milosevic et le suicide de Babic sont-ils des
coïncidences ?
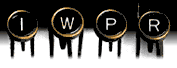 Serbie :
bataille en vue autour de la réforme des entreprises publiques
Serbie :
bataille en vue autour de la réforme des entreprises publiques


